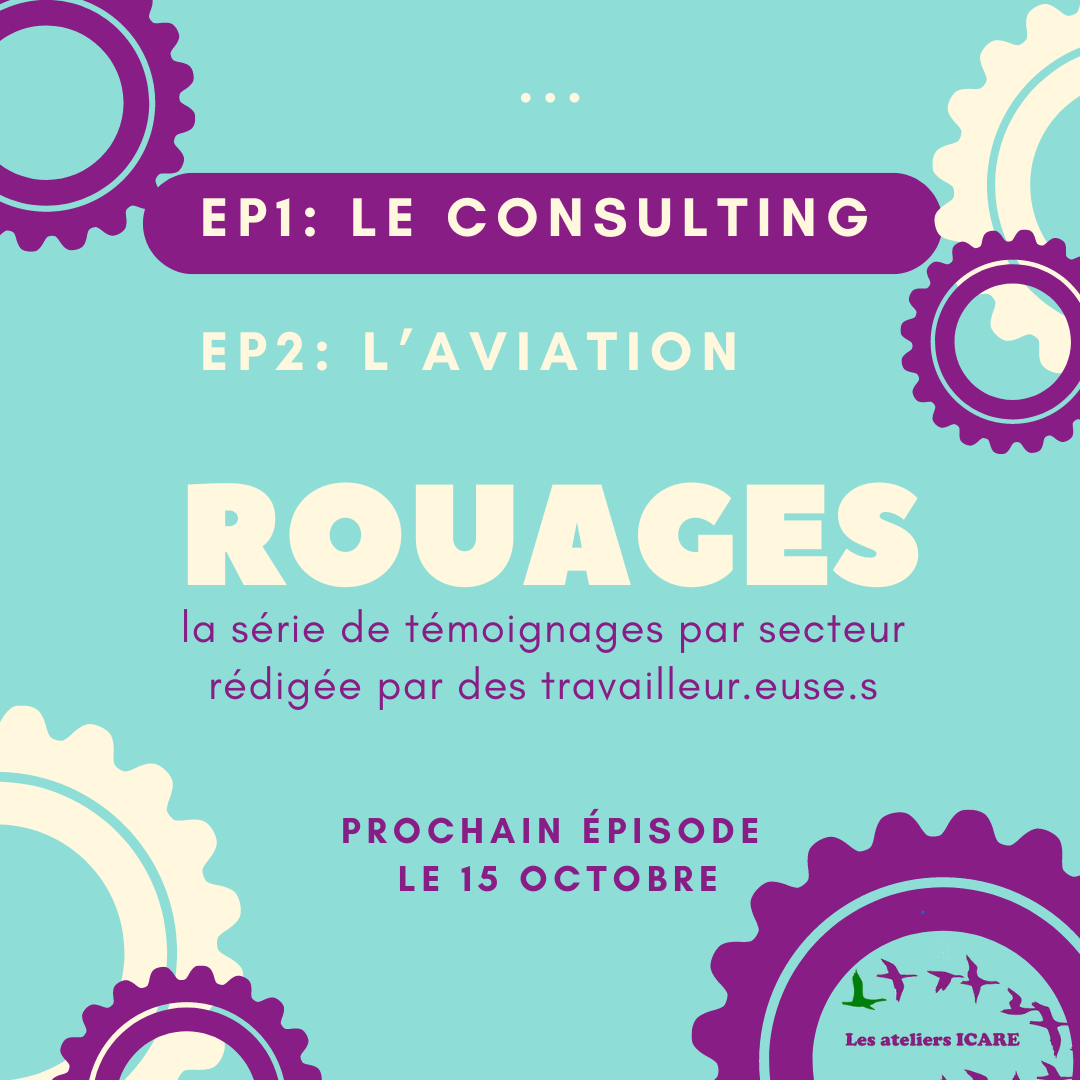Rouage : n.m chacune des pièces d’un mécanisme.
Les travailleuses et les travailleurs sont-ils les rouages d’une société malade et obsolète ? Rouages est une série de témoignages de salariés et d’indépendants de différents secteurs : numérique, aviation, conseil… En trait d’union, une même perte de sens et le rejet du productivisme. Leur horizon : la quête d’un lendemain commun et soutenable.
Episode 1 : DE CONSULTANTE EN CONSULTING A CO-GÉRANTE D’UN CAFÉ COOPÉRATIF DE QUARTIER par Lucie
Je m’appelle Lucie. Je suis fille de profs. J’ai toujours été première de ma classe. J’obtiens mon BAC Scientifique avec 18.15 de moyenne. Tu veux faire médecine ou prépa ? Prépa. (« math sup-maths spé » on disait dans le temps). Puis une école d’ingénieur. Ingénieur en quoi ? Ingénieur généraliste. Je sais, c’est bizarre, en fait ça veut dire touche à tout mais experte en rien. Et pour finir, un CDI dans une boîte de conseil en organisation pour les entreprises. J’ai l’impression de faire mes choix mais pas vraiment. Je suis l’autoroute de la réussite scolaire, sociale et économique sans me poser de question. Il aura fallu attendre que je signe mon premier contrat pour que j’envisage la bretelle de sortie.
Avant ça, je ne me projetais pas vraiment. Ma vie était faite d’échéances : 3 ans de lycée. OK. 2 ans de prépa. OK. 4 ans d’école d’ingénieur. OK. 6 mois de stage de fin d’études. OK. CDI. Euh. Attendez. CDI ? Contrat à Durée Indéterminée. La baffe. Si je ne me bouge pas les fesses maintenant je vais faire ça pour le restant de mes jours ?
« ça » c’est mon métier à la sortie de l’école : consultante. Je ne sais même plus trop comment je suis arrivée là puisqu’à la base, depuis que mon prof de SVT nous avait montré le film « Une vérité qui dérange » d’Al Gore, je voulais devenir ingénieur en environnement1. Peut-être que j’ai fini consultante parce qu’ingénieur en environnement ça n’existe pas. Ingénieur en traitement des eaux usées ou ingénieur en panneaux solaires, oui. Mais ingénieur en environnement cela ne veut rien dire.
Toujours est-il qu’à l’époque, je m’accommode de mon statut de consultante en réservant ma conscience écologique à ma vie personnelle : je trie mes déchets, je ne mange plus de viande et je bloque des ponts avec Extinction Rébellion.
Mon métier consiste à être une secrétaire de luxe. Luxe car je coûte environ 1000€ par jour à mes clients. Pour la plupart de mes missions, le « conseil en organisation » s’apparente plutôt à de la prestation de services : je fais le travail que des personnes internes à l’entreprise devraient faire mais ne font pas car elles sont soit débordées soit incompétentes (et donc payées à ne rien faire). Je passe mon temps à animer des réunions en visio où l’on ne se dit pas bonjour2 et où je ne dis pas ce que je pense mais j’applique les ordres de ma cliente, casque vissé sur les oreilles dans un open-space où ma voisine de bureau est en fait dans la même visio que moi. Je pilote des projets importants : je demande à l’équipe de développeurs indiens s’il est possible de mettre tel bouton de l’interface plutôt en haut à droite et de préférence de couleur verte car c’est ce que demandent les utilisateurs américains, en m’assurant dans le même temps auprès de l’équipe française que cela passera le contrôle qualité. Et de coder ça en 2 jours s’il vous plaît pour ne pas prendre de retard sur la campagne de tests. Dans le monde du conseil on ne dit pas « salariés », on dit « collaborateurs ». On ne dit pas « patron », on dit « coach ». On ne dit pas «subir un management violent », on dit «faire preuve de bienveillance». On ne dit pas « faire un burn-out », on dit « ne pas avoir la capacité de travailler sous pression ». Je me demande comment j’aurais réagi si j’avais su à l’époque ce qu’était un syndicat, une convention collective, à quoi sert la médecine du travail, ce qui est acceptable ou non de mettre dans un contrat de travail, et finalement connaître mes droits en tant que travailleuse. Un emploi c’est mettre ma force de travail, mon temps et mon énergie au service d’un patron en échange d’un salaire dans un cadre réglementé. Mais l’entreprise réussissait à me le faire oublier grâce à ses séminaires, afterworks, voyages au ski et baby-foot en salle de pause.
Je passe mon temps à animer des réunions en visio (…) casque vissé sur les oreilles dans un open-space où ma voisine de bureau est en fait dans la même visio que moi.
Et puis, les matins où je me lève et je me demande “pourquoi ?” sont de plus en plus nombreux. À quoi servent ces projets sur lesquels je travaille ? Sont-ils prioritaires ? Sont-ils utiles au monde ? Nicolas Hulot vient de démissionner en direct à la radio (oui, je ne suis pas très fière d’avoir cet exemple en mémoire mais c’est ce qui s’est passé…), tout est foutu. Même le ministre de l’Environnement ne peut pas sauver l’Environnement. L’effondrement de la société telle que je la connais, la civilisation occidentale thermo-industrielle, est inévitable. On va droit dans le mur.
Et moi, pendant ce temps, j’optimise des flux, invente des processus, organise le travail au sein d’entreprises (privées comme publiques) si déshumanisées, si déshumanisantes, si absurdes, si complexes, faites d’autant de couches dans l’organigramme qu’il y a d’étages dans le gratte-ciel qui les abrite (d’ailleurs la position qu’on a dans l’un correspond à celle qu’on a dans l’autre)3. Des gens dorment dehors dans ma rue. Et moi, pendant ce temps, je développe une énième version d’un logiciel. L’Australie crame et le Bangladesh est sous l’eau à cause du changement climatique. Et moi, pendant ce temps, je travaille pour une entreprise qui collectionne les scandales dans les médias, accusée de sous-notation forcée de ses salariés. 2500 migrants se sont noyés dans la Méditerranée cette année. Et moi, pendant ce temps, je travaille pour des entreprises dont l’objet social n’est pas de répondre à un besoin ou de servir l’intérêt général mais de faire du profit en exploitant des êtres humains et des écosystèmes naturels. Enfin, peut-être qu’à l’origine ces entreprises avaient un objet social noble : transporter, soigner, fournir en électricité la société. Mais il est clair que cela n’est pas (plus ? L’a-t-il un jour été?) l’unique but poursuivi par les institutions. D’avoir privatisé les brevets et les moyens de production, d’avoir instauré une course au profit et une concurrence internationale au sein du marché, là est l’inconciliable machinerie avec la quête du travail juste et bien fait.

Je me suis perdue. Je me sens paumée. Bonne nouvelle, je ne suis pas seule. Je trouve une communauté d’autres paumé·e·s comme moi sur facebook, « la communauté à rejoindre quand t’as envie de tout plaquer ».
Le 12 février 2019, j’organise mon premier événement public de paumée sur le thème « Travailler moins pour vivre plus ». On me remercie, me félicite. J’ai fourni un travail pour préparer cet événement qui a été utile à des gens, j’ai apprécié le faire et en plus je suis valorisée pour cela. Bingo ! Le 15 février je pose ma démission.
Vraiment ? Tu es sûre de vouloir partir ? C’est très juste et admirable tes valeurs et tes ambitions pour changer le monde mais justement, les entreprises ont un rôle à jouer là-dedans ! Et toi, c’est en jouant ton rôle depuis l’intérieur du système que tu vas pouvoir changer les choses ! Je n’y crois pas. Moi ? Consultante junior de 24 ans je vais réussir à convaincre mes clients que leur métier, et l’entreprise pour laquelle ils travaillent qui emploient des milliers de personnes, détruit la planète, perpétue la violence sociale, et que donc il faudrait penser à changer de modèle ?
Que faire alors ? Attendre d’avoir 10 ans de bouteille pour enfin espérer avoir une écoute et du pouvoir (en supposant que d’ici là j’aurai réussi à ne pas me faire acheter mes convictions par un salaire qui paie le prêt de la maison et un Comité d’Entreprise qui offre des places pour Disney pour les enfants) ? Non, cette stratégie est vaine puisqu’il y aura toujours les actionnaires pour me virer si je venais à trop mettre en danger leurs porte-monnaies comme le cas récent d’Emmanuel Faber chez Danone.
Non. Je pars. Je choisis la pilule rouge4.
Prise de recul. Temps libre. Bilan de compétences. Engagement associatif. Il me faut du sens ! J’abandonne avec une facilité déconcertante la casquette d’ingénieure. Je suis rapidement convaincue que ce n’est pas depuis cette place, en tout cas pas depuis les postes de « chargée de projet/chargée de mission/chargée d’affaires/ingénieur » proposés par les entreprises ou la fonction publique, que je vais pouvoir agir, sans fausseté de discours, sans violence dans les rapports humains, sans satisfaction aveugle des actionnaires et gestionnaires.
Prise de recul. Temps libre. Bilan de compétences. Engagement associatif. Il me faut du sens !
Et plus spécifiquement sur le métier d’ingénieur, la technique ne nous sauvera pas car la technique n’est pas neutre et aujourd’hui elle sert la fuite en avant vers un monde ni juste ni soutenable. Tant que l’arbitrage entre tel ou tel projet sera fait en fonction du gain pour l’entreprise ou du nombre d’emplois créés plutôt que de l’intérêt général, de la réduction des inégalités et du respect du vivant, alors non, je ne serai pas ingénieure. Moi, déserteuse démissionnaire, je refuse de continuer à robotiser, mécaniser, optimiser, informatiser, accélérer, déshumaniser le monde.5
Je me rabats sur un autre domaine qui veut me vendre du sens et des réponses à mes aspirations d’idéaliste. L’Économie Sociale et Solidaire. Je trouve un poste de « chargée de développement » (comprendre « trouver des sous pour payer les salaires ») dans une association qui fait de l’éducation à l’environnement pour les scolaires.
Je commence ce travail en pleine pandémie de covid-19. Les écoles ferment. Le monde s’arrête. Prise de recul n°2. Au début j’y crois. Je me dis « Super ! Ce virus ouvre la brèche vers le monde d’après ». La violence écologique et sociale de la mondialisation ainsi que le cynisme, le mépris et les mensonges des classes dirigeantes sont révélés aux yeux de toustes. Nous sommes forcément à un point de non-retour.
J’organise en ligne un apéro « Paumé·e dans ma démocratie » et ma conscience politique s’élargit encore un peu plus, moi qui n’avait pas compris à l’époque le mouvement des gilets jaunes.
Je n’attendais déjà plus rien des entreprises. Désormais, je n’attends plus rien de l’État.
Et le modèle économique de mon association repose sur quoi ? L’argent des entreprises et de l’État. Suis-je vraiment libre d’agir donc ? En plus, je suis mal à l’aise avec le discours « regardez les enfants, la planète brûle, il faut bien que vous pensiez à trier vos déchets ! ». C’est plutôt une classe composée des 68 milliardaires, responsables d’autant de pollution que la moitié de la population mondiale, que je devrais avoir en face de moi !
Je démissionne.
Prise de recul n°3. Je lis Karl Marx, Ivan Illich, André Gorz (dont la pensée est assez bien résumée par les paroles d’Orelsan6: « t’achètes une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour payer la voiture que tu viens d’acheter »), Simone Weil (à ne pas confondre avec la femme politique) et tou·te·s ces philosophes qui ont questionné le travail, la liberté, l’autonomie et la dépendance. Pourquoi travailler ? Pour qui ?
Comment arrêter de jouer les hamsters en cage ? Comment sortir de la dépendance sociale et économique au travail ?
La pandémie, par son arrêt brutal de la vaste machinerie industrielle du capital, a permis de rappeler à notre existence l’ensemble des bases matérielles nécessaires à notre mode de vie occidental et notamment de visibiliser ces métiers dits « essentiels ». Quelles activités sont effectivement essentielles ? De quoi le monde a besoin ? De quel « monde » parle-t-on ? Où puis-je être, à cet instant présent, la plus utile ? Sans me corrompre ? Sans entretenir (voire même en le combattant ?) le capitalisme néo-libéral et le monde mortifère qu’il me réserve ?
J’ai dressé une liste non-exhaustive des métiers qui me semblent être importants pour l’avenir : paysanne, électricienne, plombière, menuisière, charpentière, boulangère, bricoleuse, bâtisseuse, couturière, réparatrice, enseignante, travailleuse sociale, soignante, philosophe, comédienne, poète, musicienne, écrivaine, chanteuse…
J’ai dressé une liste non-exhaustive des métiers qui me semblent être importants pour l’avenir : paysanne, électricienne, plombière, menuisière, charpentière, boulangère, bricoleuse,
Que choisir ?7 Déjà, commencer par faire le deuil de pouvoir tout faire. Il faut que je trouve ma place dans le grand rouage de la transition. Et que je fasse confiance aux autres pour qu’iels trouvent leur place et fassent leur part aussi. La pandémie a réveillé chez moi la volonté de contribuer au retour du lien social à l’échelle locale et d’aider à entretenir des réseaux de solidarité entre voisin.e.s. En plus je suis forte à ça : créer du lien, faire la conversation, écouter les gens.
Je décide donc de reprendre un café coopératif dans mon quartier où est proposée de la petite restauration végétarienne le midi, un bar en soirée, une programmation culturelle, sociale et politique : des conférences, des débats, des groupes de paroles, des après-midis scrabble, une distribution hebdomadaire de légumes, un frigo solidaire, des repas suspendus, …

Le statut coopératif implique que l’entreprise appartienne à un collectif d’une cinquantaine de personnes. Cela permet d’effacer la hiérarchie, de collectiviser l’organisation du travail, de répartir les responsabilités. Pas d’actionnaires ni de dividendes versés. Les bénéfices sont réinvestis dans l’entreprise pour qu’elle continue de servir son objet social.
Voilà où j’en suis aujourd’hui et où j’ai trouvé mon sens même si tout n’est pas toujours facile et que je fais encore face à mes contradictions :
- porter un projet politique radical mais payer les charges de l’entreprise grâce à un modèle économique rentable dans le monde capitaliste (qui repose sur la vente d’alcool, deuxième cause de mortalité évitable en France après le tabac) ;
- constater le peu de mixité sociale dans la fréquentation du lieu, son usage étant culturellement réservé à seulement une partie de la population ;
- travailler en collectif et composer avec les histoires personnelles, sociologiques et les cultures politiques différentes, les egos et les rivalités, les violences symboliques…
Quoi qu’il en soit, cet emploi est la forme de travail la plus libre que j’ai pu trouver en l’état actuel de mes réflexions (qui continueront pour sûr d’évoluer !). J’y trouve non pas la liberté de « ne travailler jamais » mais celle de ne pas perdre ma vie à la gagner, en accomplissant des tâches monotones dans un cadre hiérarchique. Comme dirait Aurélien Berlan dans son ouvrage Terre et Liberté8, « derrière la critique du travail, on confond souvent le salariat (le travail payé, discipliné, morcelé) et toute forme d’activité éprouvante liée à la subsistance quotidienne. Mais ce n’est pas l’effort en tant que tel […] qui est pénible et assommant : c’est le fait qu’il soit imposé par autrui et que son caractère spécialisé fasse obstacle à l’expression de la diversité de nos facultés.»
Ce qu’il faut finalement c’est re-politiser notre travail. Et pas uniquement le métier d’ingénieur, tous les métiers ! Se demander constamment dans l’exercice de notre travail comment le faire évoluer vers plus de justice, plus de démocratie et dans le respect des équilibres écologiques. Parce que, quelle que soit notre place, nous sommes responsables. Et que finalement ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment, bien plus que notre CV ou nos compétences.
finalement ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment, bien plus que notre CV ou nos compétences
Rouages est une série d’articles coordonnée par Les ateliers ICARE, association de salarié.e.s et indépendant.e.s voulant réconcilier travail et écologie. Le productivisme, ça te parle ? Tu travailles dans la publicité ? Tu es technicien forestier ? Professeur d’économie ? Propose-nous le prochain article de Rouages via ateliersicare@ecomail.fr.